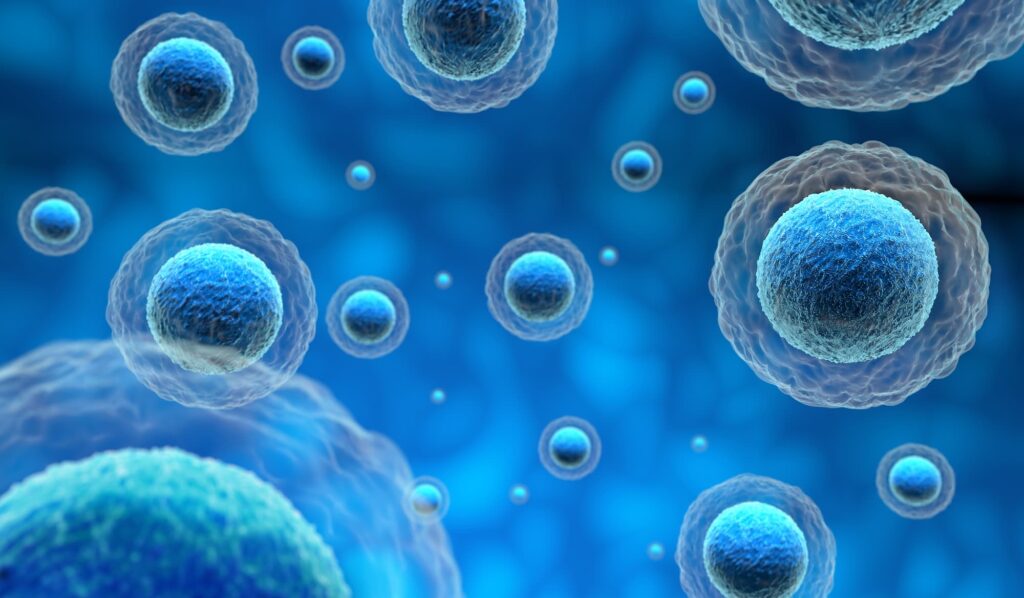La recherche n’a jamais été aussi intense. Notamment en médecine, elle connaît un essor considérable – aussi en raison du coronavirus. Et de plus en plus souvent, les personnes concernées ne veulent ou ne doivent plus être de simples objets passifs dans cette intense activité de recherche, mais apporter leur propre contribution. Cela profite à la recherche et, en fin de compte, aussi aux personnes concernées elles-mêmes. C’est pourquoi de plus en plus d’études et de projets scientifiques impliquent activement les personnes concernées.

Trois sites au rayonnement européen
Rapprocher les chercheuses et chercheurs et les personnes concernées et donner ainsi un élan supplémentaire à la recherche, c’est aussi ce qu’a entrepris le Centre de rhumatologie expérimentale de l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ). L’institut est un centre de référence européen pour la recherche sur les rhumatismes, qui publie environ 80 études par an. Il est le fruit d’une collaboration entre l’USZ et la Clinique universitaire de Balgrist et il est intégré dans différents réseaux de recherche nationaux et internationaux. Le centre emploie aussi bien des rhumatologues cliniciens que des biologistes, des pharmaciennes et pharmaciens et d’autres expertes et experts. Les recherches sont menées sur le «Balgrist Campus» moderne et dans le «BioTechnopark» sur le site de Schlieren de l’USZ. Et c’est précisément là que les personnes concernées et d’autres personnes intéressées ont été invitées en septembre à la première journée portes ouvertes du centre de recherche.
Une cinquantaine de participantes et participants ont reçu des explications de première main de la part des chercheuses et chercheurs sur les priorités de leur recherche et les questions les préoccupant actuellement. Il a été aussi bien question des différents tableaux cliniques rhumatismaux que de ce qui se passe en laboratoire avec un don de tissu ou de sang. Lors d’une visite des différents locaux du laboratoire, les personnes concernées ont été emmenées dans un voyage passionnant depuis l’échantillon de recherche jusqu’à la publication des résultats de l’étude. Les chercheuses et chercheurs ont parlé de leur travail avec beaucoup d’engagement et des questions ont pu être posées à tout moment, ce dont les participantes et participants ont largement profité.

Une grande équipe
Il s’est avéré que le niveau de connaissances n’était pas le même pour toutes les personnes participantes. L’une ou l’autre personne semblait s’être déjà intéressée de près à la recherche sur sa propre maladie. Ou travaillait peut-être même elle-même dans un laboratoire de recherche. La visite et l’apéritif qui ont suivi ont ainsi donné lieu à des discussions intéressantes, qui allaient déjà dans le sens de la collaboration souhaitée par les scientifiques avec les personnes concernées.
En effet, la manifestation était également une sorte de «coup d’envoi» pour un projet visant à intégrer la perspective des patients dans les études scientifiques. Les chercheuses et chercheurs espèrent une collaboration à long terme avec les personnes concernées. Leur perspective doit être intégrée dans chaque phase d’un projet de recherche, selon Florian Klett, responsable du projet en question. Il s’agit de mettre à profit le savoir empirique des patientes et patients pour la recherche. Les personnes concernées intéressées peuvent désormais s’annoncer jusqu’à la fin de l’année pour faire part de leur intérêt à participer (voir encadré). À partir de 2023, il est prévu d’organiser une séance de formation suivie de rencontres d’échange régulières. Cette collaboration doit aussi faire plaisir, a souligné le responsable du projet. L’objectif des chercheuses et chercheurs est d’intégrer les patientes et patients en tant que partenaires dans les projets de recherche et de collaborer avec eux sur un pied d’égalité. Ils doivent devenir des membres de l’équipe et ne pas agir uniquement en tant que patientes et patients de l’étude.

Des solutions aux problèmes les plus urgents
Le centre de recherche y voit une initiative à long terme. Car le chemin entre une première étude et une découverte révolutionnaire ou un nouveau médicament est également long. Et les personnes concernées ne peuvent pas apporter leur contribution partout sur ce chemin. Les chercheuses et chercheurs du Centre de rhumatologie expérimentale sont néanmoins convaincus que cette approche permet de faire avancer à la fois les personnes concernées et la recherche. Ils sont donc très intéressés de savoir quels sont les problèmes les plus urgents des personnes atteintes d’une maladie rhumatismale, afin d’y chercher des solutions. Pour ce faire, à part la collaboration avec les personnes concernées, un échange aussi intensif que possible entre les médecins traitants, les chercheuses et chercheurs et d’autres spécialistes est toujours nécessaire.
La recherche reste très importante pour les personnes concernées
Car il reste encore beaucoup à faire. Les possibilités de traitement actuelles de la spondylarthrite ankylosante sont dues à la recherche des dernières décennies. Et la recherche est également une préoccupation importante pour les membres de la SSSA. Lors de l’enquête auprès des membres, 94% des personnes concernées ont ainsi indiqué que la recherche visant à améliorer les possibilités de traitement contre la spondylarthrite ankylosante était importante pour elles. 70% des participantes et participants estiment qu’il est important d’en savoir plus sur les causes et les déclencheurs de la spondylarthrite ankylosante. Ils peuvent donc désormais y contribuer eux-mêmes en devenant des «partenaires de recherche».
Les personnes atteintes de spondylarthrite ankylosante et d’autres maladies rhumatismales sont invitées à s’annoncer jusqu’à la fin de l’année auprès du Centre de rhumatologie expérimentale de l’Hôpital universitaire de Zurich (USZ). L’objectif est d’établir une collaboration à long terme entre les personnes concernées et les chercheuses et chercheurs. Une première formation aura lieu début 2023, suivie de rencontres d’échange régulières. Les conditions préalables sont l’expérience de la maladie, l’intérêt pour la recherche et le temps nécessaire pour les rencontres. Les personnes concernées devraient par ailleurs être communicatives, avoir des connaissances de base en anglais et une certaine expérience du numérique. Les personnes intéressées peuvent s’annoncer jusqu’à la fin de l’année auprès de Kristina Bürki, experte en soins à l’USZ, sous kristina.buerki@usz.ch ou au 043 253 06 35.
Cet article a été publié pour la première fois dans la revue «vertical» No 94.